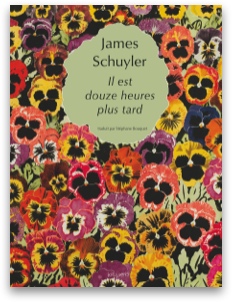
15 x 20 cm
172 pages
22 €
James Schuyler utilise la poésie pour se placer dans la conversation, dans l’échange : téléphone-moi, sonne à ma porte, écris-moi des lettres, donne-moi des nouvelles, des gestes, des baisers, des phrases.
Ce volume de poèmes choisis est donc une collection d’anecdotes, de phrases rapportées, d’événements sans importance, de fleurs qui fleurissent et de nuages qui rosissent, précisément parce que c’est la matière de la vie. Tout ceci est bien sûr faussement négligeable et parfaitement crucial. James Schuyler croit à la beauté inépuisable du monde sous la main. »
Stéphane Bouquet
Après avoir servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, James Schuyler (1923-1991) est arrivé à New York en 1944 où il a fait la rencontre de Wystan Auden, ainsi que des poètes Frank O’Hara et John Ashbery qui deviendraient de proches amis et collaborateurs. Associé à « l’école de New York », James Schuyler a côtoyé les peintres et écrit pour Art News tout en travaillant pour le Musée d’Art Moderne.
Après un premier roman, Alfred and Guinevere en 1958, James Schuyler a publié son premier recueil Freely Espousing en 1969, suivi de The Crystal Lithium (1972), Hymn to Life (1974) et A Few Days (1985). En 1980, The Morning of the Poem s’est vu décerner le prix Pulitzer.
La poésie urbaine de James Schuyler
« Poésie urbaine », tel est le premier qualificatif qui vient à l’esprit au lecteur des poèmes de James Schuyler (1923-1991), poète rattaché à une École de New York à laquelle appartiennent aussi ses amis Frank O’Hara, John Asbery ou Ron Padgett, tous traduits dans la belle « Collection américaine » que dirige Olivier Brossard aux éditions Joca Seria.
« Urbaine », la poésie l’est au moins depuis Baudelaire et ses vers fameux évoquant la forme sans cesse en mouvement (changeant « plus vite que le cœur d’un mortel ») de la grande ville. Walter Benjamin, comme on sait, avait fait de l’auteur du Spleen de Paris le poète par excellence d’une métropole en laquelle il voyait la « capitale du XIXe siècle ». C’est New York, capitale, elle, du 20e siècle, qui est au cœur des poèmes de James Schuyler. Plus qu’un décor, la mégapole est comme une basse continue dont le grand souffle accompagne la parole du poète au gré de ses migrations, tantôt du côté du bâtiment de l’ONU (« quand je vivais/ sur la 49e Est ») ou du Chrysler building, tantôt à Central Park, tantôt dans le quartier de Chelsea.
Urbaine, la poésie de James Schuyler ne l’est pas seulement par son objet, sa thématique. Elle l’est tout autant par son allure, sa vitesse, sa capacité à tout juxtaposer, entasser, agglomérer, articuler, dans l’espace du poème. D’où l’impression d’incessant mouvement chaotique, d’infatigable métamorphose, d’agitation kaléidoscopique qui s’en dégage : « Discontinuité/ dans tout ce qu’on voit et est :/ même chose, et pourtant change, / change, change. »
Le paradoxe, pourtant, est que cette poésie, en sa modernité même, en son prosaïsme délibéré, retrouve quelque chose d’essentiel au vieux pacte pastoral qui, selon le critique Paul de Man, attache le poète à la Nature. Là où Baudelaire détestait la verdure (du moins le prétendait-il), Schuyler au contraire ne cesse de chanter le monde végétal (les roses par exemple) ; de célébrer un passage des saisons dont témoignent, entrevus dans les interstices du tissu urbain, « les arbres les plus délicatement feuillus ». Ou bien, élégiaque, il dit son regret de ne plus pouvoir admirer de vieux marronniers qu’on vient d’abattre (« quand ils portaient leurs chandelles / c’était magique, souffle coupé, regard ravi. »). Et s’il aime à contempler le paysage urbain de la « ville à dents de requin », si New York la populeuse, la métropole cosmopolite et gay friendly, est sa ville, le poète se plaint cependant que « la campagne lui manque ».
À mi-chemin du haïku et du journal
Si les vieux registres de l’ode et de l’élégie sont ainsi réveillés (il faudrait y ajouter celui de la lyrique amoureuse), c’est cependant sans emphase aucune, de la plus discrète des manières. « Je veux seulement dire, voir et dire, les choses/ comme elles sont », écrit James Schuyler. Ce refus de toute poétisation, ce parti pris de littéralité, confère à ses poèmes une vivacité et une véracité rares. « Nous sommes vivants », voilà l’étonnement qui est à la source de la poésie de Schuyler, une poésie, note Stéphane Bouquet dans son éclairante postface, qui « n’a radicalement rien d’autre à nous dire et c’est ce qui fait sa force. »
Toutefois, il ne suffit pas, on s’en doute, d’adopter le « ton décomplexé » du poème-conversation pour que le lecteur soit saisi par l’effet de vérité du poème. Le tranchant singulier des poèmes de James Schuyler, la vivacité de leur ton, tient pour une grande part à la forme qu’ils inventent, à mi-chemin du haïku et du journal. Du haïku, ils ne possèdent certes pas la brièveté (la profusion est au contraire un trait distinctif de Schuyler). Mais ils en partagent le sens aigu de la notation météorologique (le temps comme weather) et l’autorité que peut conférer une énonciation qui se veut simplement constative (maints énoncés sont ainsi introduits par un « C’est… » sans appel). Ainsi se trouvent capturés, avec toute la subtilité propre aux plus fines sensations, ce que Barthes appelait des « copeaux de présent » (« il pleut de la neige », par exemple). Irrécusables, ils jaillissent comme autant d’épiphanies qui font « tilt » pour la plus grande joie du lecteur. Du journal, d’autre part, ces poèmes souvent datés possèdent l’allure sans apprêt et le côté cursif. Chronique de micro-événements pris dans la succession des jours (« je suis sur ma chaise », écoutant une sonate de Scriabine et en train de « boire mon Coca » ; « le nerf/ ulnaire de mon bras droit s’est coincé je ne sais comment »), ils donnent à appréhender le passage du temps (time), l’exposition irrémédiable de l’existence à la finitude. Pour autant cette dimension de journal n’enferme pas le poète dans la sphère étroite de sa seule vie privée. Il est au contraire pleinement immergé dans ce que Stéphane Bouquet appelle la « conversation » du monde. Le journal (paper) et les nouvelles du jour qu’il publie ont en effet aussi dans ces poèmes leur place (« Le journal arrive. Il apporte une/ palanquée de mauvaises nouvelles. »).
On sait le défi que représente toujours la traduction d’un livre de poésie. Si la version française ici proposée des poèmes de Schuyler donne au lecteur ignorant de l’original un sentiment de si vive présence, c’est probablement parce que Stéphane Bouquet est aussi un poète urbain attentif à être ce « sismographe du temps qui passe et du temps qu’il fait », « en quête perpétuelle du présent », qu’il croit reconnaître chez l’auteur qu’il traduit. Et écrivain sismographe capable de symbiose avec la conversation urbaine, Stéphane Bouquet l’est d’autant mieux que sa propre pratique de la poésie est transdisciplinaire. Également scénariste et danseur, il était ainsi à Nantes en septembre dernier, d’une part à Honolulu, l’espace d’expérimentation attaché à la danse que dirige Loïc Touzé, et d’autre part au Cinématographe, où il a donné une leçon de cinéma autour de Beau fixe sur New York, un film musical (et chorégraphié) de Stanley Donen et Gene Kelly. n
Jean-Claude Pinson, Place publique #48, novembre 2014